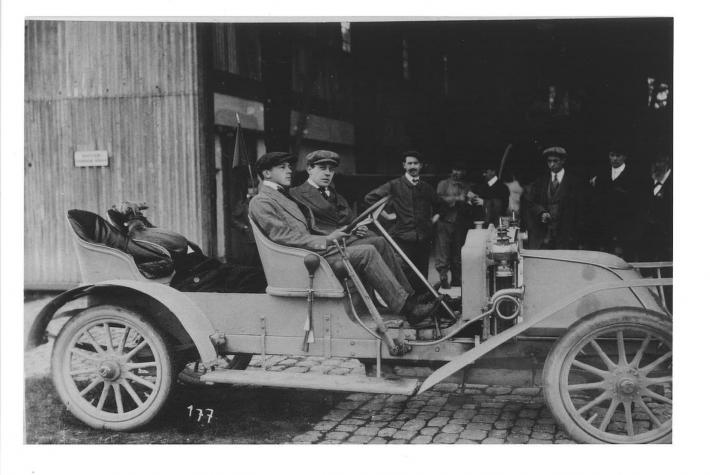Création lucensoise pour les 10 ans de Graines de foot
C?est en l?an 2000 que germe dans l?esprit de Georges Guinand, instituteur à Lucens, l?idée d?organiser un tournoi de football à l?échelle cantonale. Président de la commission juniors de l?Association cantonale vaudoise de football, il souhaite mettre sur pied une manifestation réservée aux enfants.
«C?est grâce au soutien de Nathalie Panchaud, à l?époque responsable du marketing à24 heures,que j?ai pu réaliser mon projet» se souvient Georges Guinand. Il ajoute que dix ans après la création du mouvement, l?objectif reste «la promotion du football chez les jeunes, tout en leur offrant du plaisir à jouer leur «Mundialito». Un état d?esprit qui n?exclut pas la détection de nouveaux talents.
Budget de 100 000 francs
La première édition a lieu en 2001 et elle ne concerne que la catégorie des juniors E. En 2004, les juniors D participent pour la première fois à Graines de foot.
L?édition 2008 s?ouvre également aux juniors F et aux personnes en situation de handicap mental.
En 2010, ce ne sont pas moins de 7500 jeunes footballeurs de 8 à 13 ans qui participent à cette grande fête du football organisée à leur intention. Pour chaque édition, le budget nécessaire au financement des t-shirts, coupes, ballons de matches et médailles s?élève à 100 000 francs. «C?est grâce au soutien de dix-huit partenaires que Graines de foot peut exister et se développer», précise le fondateur du mouvement.
10 000 t-shirts
Architecte à Lucens, Jean-Daniel Liechti pratique à temps perdu (il en a trop peu!) l?art du dessin et de la caricature. Avec finesse et un sens de l?observation affûté, il met en situation des personnages issus de son imagination, qu?il a fertile.
C?est donc tout naturellement que Georges Guinand s?est approché de son pote, à l?heure de créer un motif destiné à habiller les t-shirts et les affiches du 10eanniversaire deGraines de foot. «On se connaît depuis une trentaine d?années, époque à laquelle nous habitions dans le même immeuble» explique l?architecte. Il ajoute avoir dessiné en son temps le motif du faire-part de naissance d?un fils de Georges et Martine Guinand. Il s?en est inspiré pour illustrer l?énergique coup de pied qui fait exploser le ballon en feu d?artifice.
Un motif né de la souriante complicité entre les deux Lucensois, et qu?on retrouvera donc sur les 10 000 t-shirts qu?arboreront les jeunes footballeurs ce week-end
Un message clair
Georges Guinand précise enfin que la Licra (ligue contre le racisme) est un partenaire apprécié deGraines de foot. Dans le dernier Flash Foot Juniors, l?organe de la commission des juniors de l?ACVF, le président Dominique Blanc prend clairement position sur le sujet.
Il écrit notamment: «L?éducation, voilà la meilleure clé pour lutter contre les peurs, les apriorismes, l?ignorance, les fausses croyances, le manque de respect. On est dans le domaine des éducateurs, des entraîneurs et leur rôle est déterminant car ils ont les jeunes au moment où se forment les codes comportementaux. Leur message doit être clair: Nous ne connaissons qu?une seule langue, celle du football. Nous ne connaissons que la couleur des maillots. Nous ne connaissons qu?un passeport: la licence ASF. Nous ne connaissons qu?un chant: celui de la victoire sportive. Car nous sommes tous membres de la même famille: celle du football?»