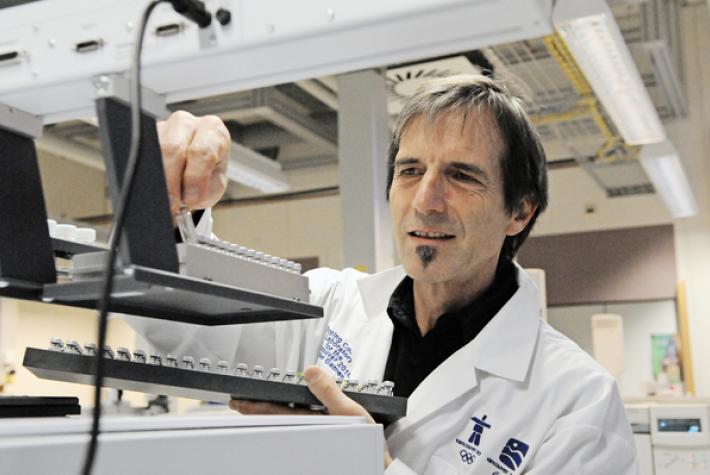L’énergie solaire fait son nid sur les toits des constructions agricoles
MODE Les agriculteurs qui se lancent dans la production d’énergie solaire sont toujours plus nombreux en terre broyarde. Regard sur un phénomène dans l’air du temps qui représente un revenu loin d’être négligeable pour la profession.
«J’aime bien dire que j’ai fait ma caisse de retraite avec cette installation», plaisante, optimiste, Raymond Duc. Le toit de l’écurie de cet agriculteur de Sarzens arbore un parc photovoltaïque de 950?m2, depuis un peu plus d’une année. Le petit village compte d’ailleurs deux fermes solaires pour environ huitante âmes, et à l’image de Sarzens, c’est toute la campagne broyarde qui se garnit de ces bâtiments à double vocation agricole et énergétique, poussant un peu comme des champignons.
«Entre 2009 et 2013, nous avons réalisé, dans les Broye vaudoise et fribourgeoise, 21 installations photovoltaïques chez des agriculteurs. Parmi elles, onze ont été effectuées lors de l’année passée uniquement. Je pense que le nombre de chantiers annuels va stagner maintenant», commente Jean-Louis Guillet, directeur de l’entreprise Soleol basée à Estavayer-le-Lac.
Pour expliquer l’ampleur de ce phénomène, outre les considérations liées à l’écologie ou à l’autonomie, les arguments économiques sont évidents.
«Plus du business»
C’est que l’agriculteur de Sarzens revend la totalité de l’électricité produite par son installation. «Je suis au bénéfice du Pont Vaudois depuis le 1er janvier. Le canton me rétribue à 90% du coût de production», explique Raymond Duc. En 2012, le Conseil d’Etat décidait en effet de consacrer un montant de 15 millions de francs afin de mettre en place un pont cantonal, prévu pour les projets photovoltaïques en attente du programme de la Confédération, rétribuant à prix coûtant le courant injecté (RPC). «Je vais bénéficier de la rémunération cantonale pendant deux ans. D’ici là, j’espère que mon projet sera accepté par Swissgrid», continue l’agriculteur. Plus de 10 000e sur la liste d’attente de l’organisme national, celle-ci comptabilise environ 31?000 projets, dont plus de 29?000 consacrés à l’énergie solaire. Autant dire que les démarches afin d’obtenir la rémunération fédérale relèvent du parcours du combattant. Le Sarzensois confie: «il faut être aussi entrepreneur, car c’est plus du business que de l’agriculture».
En bref, un investissement de 350?000?francs pour un revenu annuel prévu à 50?000?francs brut. Fort de la stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral, censée, entre autres, promouvoir les énergies renouvelables, la RPC compense aux producteurs indépendants la différence entre le coût de production de l’électricité et son prix du marché, sur une période de vingt ans. A noter que la durée de vie estimée des installations photovoltaïques est de vingt-cinq ans, avec une légère baisse de la production au fil des années. Alors, ça se bouscule au portillon.
Du côté du canton, la Direction générale de l’environnement voit d’un œil favorable les initiatives privées permettant de développer le potentiel énergétique des toitures. «L’ensemble des sources de production sera nécessaire pour atteindre les objectifs de la sortie programmée du nucléaire», commente Denis Rychner. «Toutefois, les agriculteurs doivent faire appel à des professionnels afin de s’assurer de la viabilité technique et économique de leur projet.»
Mise à jour des réseaux
Enfin, s’il y a autant d’agriculteurs qui se lancent dans le solaire, c’est d’abord parce qu’ils ont des surfaces de toitures inutilisées importantes. «Il faut être idéalement orienté au sud. La quantité d’électricité produite par mon installation en plein été, un jour de grand beau, est supérieure aux besoins de tout le village de Sarzens», explique Raymond Duc.
Les distributeurs d’énergie, quant à eux, doivent alors faire face à des masses d’électricité produites que le réseau doit être capable d’absorber. «Le raccordement de bâtiments agricoles isolés nécessite souvent un renforcement du réseau, ce qui implique des travaux supplémentaires», explique Luc D’Alessandro, porte-parole à Romande Energie. Une mise à jour des réseaux électriques des petits villages est alors souvent nécessaire. A Sarzens, «le transformateur a dû être changé», précise Raymond Duc, «car l’ancien ne pouvait absorber que la moitié de ma production».
Et à la question de savoir pourquoi l’agriculteur ne satisfait pas d’abord sa propre consommation, sa réponse relève du pragmatisme. L’énergie solaire ne se stocke pas et la production est nulle les jours de pluie, ce qui rend son utilisation difficile pour une exploitation agricole. «Nous faisons la traite de nos vaches tous les matins et soirs. L’hiver, il fait tout simplement nuit…»
- Plus d'infos dans notre édition de la semaine.